72 - septembre 2013
Numéro 72 - septembre 2013
Editorial
Le hasard des circonstances – divorce, absence… – a fait en sorte que je me sens beaucoup moins redevable envers mes parents, en termes d’éducation,…

L'esprit du temps
Turritopsis nutricula, méduse de 4,5 mm de diamètre, est, en principe (ses prédateurs sont nombreux), immortelle : elle revient à sa formule juvénile …

Les Femen ne jurent que par un obscur penseur allemand du XIXe siècle. Mais en ressaisissant le contexte dans lequel elles l’ont découvert, on…

Les récentes manifestations ont brisé l’image idéale du bilan des années Lula. Quelles tensions travaillent aujourd’hui ce pays ? Le sociologue Sergio Adorno, spécialiste de la violence, livre son analyse.
Le cas du lanceur d’alerte Edward Snowden invite à réfléchir à la dose de courage qu’il faut pour s’opposer activement à des ordres illégaux au…

Et si, à l’origine, l’humanité employait un seul et même idiome ? C’est ce qu’avancent certains linguistes, peut-être encore hantés par le mythe…

La personnalitéMario Rubio« L’Obama des Latinos », républicain et pour la réforme de l’immigrationC’est celui qu’on présente comme « l’Obama des Latinos ». Fils d’immigrés cubains, Mario Rubio, sénateur à 40 ..
Le Comité consultatif national d’éthique a rendu son avis sur la légalisation de l’euthanasie le 1er juillet dernier. Certaines voix dissonantes…

Résonances / Septembre 2013
Publié leCe mois-ci. La bible socialiste des Femen / Le sociologue brésilien Sergio Adorno décrypte les violences qui secouent son pays / Le courage numérique d’Edward Snowden / Euthanasie : l’avis rendu du Comité consultatif national d’éthique a relancé le débat national sur le sujet / L’idée d’une langue mère de l’humanité : réalité ou mythe ?
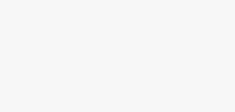
Maïa, 7 ans et demi

Maxime Crombée, 15 ans, Paris
«Le poisson pourrit par la tête, dit-on souvent chez Poujade. On retrouve ici l’ordinaire discrédit jeté sur le cerveau, dont la disgrâce fatale…

Horizons
C’est en Lozère que le chercheur en philosophie Baptiste Morizot est parti, en compagnie d’un trappeur, sur les traces de cet animal redouté par…

En 1947, Jimmy P., un Indien Blackfoot revient de la guerre en proie à un lourd traumatisme. Son cas est un défi pour la psychanalyse. Un…

Dossier
Il y a encore quelques années, s’interroger sur la bonne éducation sonnait comme une provocation ou de l’ironie, tant l’expression est passéiste et socialement connotée, renvoyant à l’image inégalitaire et hypocrite de l’éducation bourgeoise. Depuis…
En France, le mythe d’un système d’éducation unique, égal et délivrant le même savoir à tous est toujours vivace. Pourtant, sitôt qu’on invite quelqu’un à raconter son parcours, on s’aperçoit qu’il est semé d’anomalies et d’imprévus. Le…
Avec l’École 42, son université numérique gratuite, Xavier Niel, fondateur de Free, prétend révolutionner l’éducation et préparer les jeunes à la…

« J’ai eu une éducation scolaire bousculée et acrobatique qui s’est terminée prématurément en 1968 [lire le grand entretien avec Bernard Stiegler]. Je viens d…

“Nul n’entre ici s’il n’est géomètre” avait inscrit Platon au fronton de son Académie. Et aujourd’hui ? Cinq philosophes reviennent sur leur…

« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre » avait inscrit Platon au fronton de son Académie. Et aujourd’hui ? Cinq philosophes reviennent sur leur…

« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre » avait inscrit Platon au fronton de son Académie. Et aujourd’hui ? Cinq philosophes reviennent sur leur…

À ne voir dans les règles de civilité que le masque de l’hypocrisie sociale, nous autres, Modernes, avons oublié leurs vertus libératrices, soutient le philosophe Philippe Raynaud. Explications.
Menacées par les tyrannies marchandes, les humanités sont pourtant essentielles à la citoyenneté, soutient la philosophe américaine Martha Nussbaum. Mais à condition de les élargir au pluralisme des civilisations, à une culture de l…
Leon Battista Alberti (1404-1472) Qui est-ce ? Né à Gênes, Alberti est l’une des grandes figures de la Renaissance italienne. Son œuvre Della Famiglia …

Qu’est-ce qu’une bonne éducation ?
Publié leÀ l’évidence, le temps des grandes certitudes est derrière nous : la question de l’école s’est muée cette dernière décennie en un champ de bataille, une dispute désespérément cacophonique. L’idéal égalitaire promu depuis les années 1970 ? Difficile de nier qu’il entretient une inquiétante tendance à la démotivation, l’incivilité, voire l’inculture. L’idéal traditionnel à la sauce Jules Ferry ? Il nous est tout aussi difficile d’envisager sérieusement un retour aux hussards noirs et aux bonnets d’âne. Nous sommes désorientés ? C’est sans doute qu’il est temps de nous élancer par-delà les affrontements stériles entre partisans d’une nouvelle école imbibée de modernité électronique et chantres d’une ancienne école imperméable à la rumeur du monde. Tel est l’enjeu pointé par les nombreuses voix rassemblées dans ce dossier : une autre école est possible qui viserait un idéal humaniste réinventé. Où les grands fondamentaux – civilité et culture générale – se trouveraient revitalisés par les nouvelles pratiques – art de la controverse, culture empathique, ressources du jeu – et vice versa. Signe que le temps est venu pour un débat enfin attentif aux voies inventives et aux positions nuancées ?

Idées
Dans ce passage de De l’existence à l’existant, Emmanuel Levinas expose sa vision de l’insomnie. Il y voit le lieu d’une révélation de la nature impersonnelle du sujet. Mais en voulant exprimer l’expérience de l’anonymat, c’est la…
« Chaque fois qu’[une] identité s’annonce, chaque fois qu’une appartenance me circonscrit, si je puis dire, quelqu’un ou quelque chose crie : attention, le piège, tu es pris. Dégage, dégage-toi. » Derrida ou la phobie de l’enfermement…
Comment s’en servirSi votre adversaire se montre convaincant, interrompez-le en disant : « Ce que vous dites est peut-être vrai en théorie, mais, en pratique, ça ne vaut rien. » Imaginons que le débat porte sur le temps passé par les…
GrammatologieDerrida a sorti de l’oubli ce mot ancien, forgé à partir du grec gramma (« lettre », « écriture », « alphabet ») et logos (« discours »). On lit la définition suivante dans le Littré&thins..
On trouvera dans les pages qui suivent l’intégralité de la Lettre à un ami japonais. Ce texte, datant de 1985, est repris dans Psyché. Inventions de l’autre (Galilée, 1987), volume qui rassemble plusieurs articles et interventions de Derrida. La…
Jacques Derrida (de son vrai prénom Jackie) est né le 15 juillet 1930 à El Biar, près d’Alger. Issu d’une famille juive qu’il décrira comme « banalement pratiquante », il est marqué à vie par les discriminations subies par les Juifs d…
« Déconstruction » est un mot qui doit à la longue disparaître, c’est ce que pensait et souhaitait Derrida comme on peut le lire dans sa Lettre à un ami japonais. Il n’en a rien été jusqu’ici, comme nous le savons, et ce terme, qui…
Jacques Derrida et la déconstruction
Publié leIl n’est guère possible de mentionner son nom sans l’associer spontanément au terme qui a fait sa renommée. « Jacques Derrida ? Ah oui ! le penseur de la déconstruction. » Hic : c’est quoi, au juste ? Un concept, une méthode, un slogan ? Gare aux contresens… Disparu il y a un peu moins de dix ans, Derrida se méfiait terriblement des définitions trop scolaires, et, disons-le, son œuvre se révèle aussi novatrice qu’exigeante. Alors il faut reconstituer le dossier – le reconstruire. Le philosophe Frédéric Neyrat nous y aide. Il revient sur le choc que représente la pensée derridienne et montre en quoi la déconstruction désigne avant tout une manière de remettre en cause les oppositions philosophiques traditionnelles : entre la présence et l’absence, le dedans et le dehors, les vivants et les spectres… Désormais, les contraires s’imbriquent, le même est travaillé par son autre. Dans le cahier central, Jean-Luc Nancy rend hommage à celui qui fut non seulement une source d’inspiration, mais également un ami proche. Et nous fait voir à quel point la déconstruction est un geste, une exigence à toujours réitérer – aujourd’hui encore.

Ce terme désigne à Tahiti un enfant donné mais pas abandonné. De quoi éclairer sous un nouveau jour les théories des échanges.
Livres
De Darwin à Lévi-Strauss
Publié leQuel est le point commun entre Darwin et Lévi-Strauss ? Un voyage au Brésil, décisif dans leur vie. Mais surtout une passion de la diversité, biologique et culturelle, dont ils ont été les observateurs privilégiés. Si la biographie croisée du naturaliste et de l’anthropologue donne au livre son canevas, le motif qu’y tisse Pascal Picq est plutôt terrifiant : une vaste extinction d’espèces, de langues et de cultures dont Homo sapiens, « espèce qui élimine les autres formes de vie par sa multitude », est responsable. En dépit du « funeste chemin pris par l’humanité », l’auteur se défend d’être un prophète désenchanté et plaide pour une « éthique évolutionniste de la diversité » qui en passe par une réflexion sur l’hominisation. Sans oublier les « partenaires silencieux de notre évolution », ces bactéries et autres microorganismes piétinés dans une guerre des mondes invisible. Renoncer à concevoir la nature à notre image pour entrer dans l’âge d’homme : Darwin et Lévi-Strauss, c’est sûr, auraient dit oui au voyage.

La société des affects. Pour un structuralisme des passions
Publié leLénine voyait dans l’impérialisme le stade ultime du capitalisme. Voici venu le stade cosmétique qui s’empare de nos affects comme de nouveaux objets d’échange. Jusqu’au jour où nos corps, emplis de passions tristes, se retourneront contre lui. Qui a dit que le capitalisme était un système mortifère, un grand absolu inerte, réprimant toute vie dans la logique mécanique du marché ? Pour qui observe le capitalisme contemporain ou « néocapitalisme », la métaphore de la « cage d’acier » qu’employa Max Weber en son temps pour le décrire apparaît obsolète. Le « style » du capitalisme – c’est le constat de départ de Stéphane Haber – est plus proche aujourd’hui de la plasticité du vivant que de la rigidité du mort. Regardez comme il ondule sous nos yeux, comme il nous fascine et nous ressemble, imprimant sa forme, son style expansif et sa vitalité aux domaines les plus intimes de nos vies, et a priori les plus éloignés de ses prérogatives, jusque dans nos usages du bonheur et de l’amour même. On cote sur Facebook la popularité des individus par des « J’aime » comme on cote les entreprises en Bourse ; notre idéal de sérénité inclut des critères d’épanouissement et de compétitivité issus du management. D’une vitalité expansive, protéiforme, le néocapitalisme est aussi le terreau de singularités caractéristiques de sa tendance inhérente à la prolifération, que Stéphane Haber appelle des « puissances détachées », et dont les grandes entreprises multinationales ou le « monde de la finance » sont des avatars à la fois fantasmatiques et bien réels. Véritables excroissances de la vitalité capitaliste, ces puissances détachées prennent peu à peu leur autonomie par rapport aux pratiques humaines dont elles émanent (le travail, l’échange) dans un élan qui ne paraît plus viser que leur « reproduction élargie », incontrôlée, à part, indifférente aux besoins effectifs des individus.Sans préjuger de la nécessaire absurdité de leur fonctionnement, Haber s’interroge : n’y a-t-il pas, malgré l’apparente logique d’épanouissement que suggère cette remarquable « vitalité » du capitalisme, une possible « contradiction entre deux formes de vitalités », celle du système et celle des individus ? Quand les grandes agences de notation comme Standard & Poor’s ou Fitch semblent décider à elles seules de la santé économique d’un pays, quand les bénéfices d’une délocalisation pour les entreprises priment sur l’emploi local, ne sommes-nous pas les jouets de l’élan expansionniste de ces puissances ? Et cela au point de ressentir une nouvelle forme d’aliénation, qui n’est plus celle de nos vies dans le monde mort des objets mais de nos vies dans la vitalité des puissances détachées ? Sous l’impact de plus en plus impérieux, parfois très original et sophistiqué de telles puissances, certains aspects apparemment supportables de la vitalité capitaliste pourraient bien finir par devenir progressivement intolérables (le léger malaise que commence à susciter notre dépendance aux nouvelles technologies numériques illustrerait bien ce genre de transition).« La balance affective qui nous incline à l’obéissance n’a rien d’immuable »Du supportable à l’intolérable, il n’y a, du reste, qu’un pas, que permettent de franchir les affects, comme le défend Frédéric Lordon dans son dernier ouvrage. Il pourrait bien arriver un moment où la « vitalité » capitaliste ne donnera plus, passionnellement, aucune raison de souscrire à ses lois. Or cette validation passionnelle est indispensable à la « légitimité » des grandes structures qui quadrillent la société : c’est elle, à terme, qui fonde la légitimité des institutions, de l’école, du tribunal ou de l’entreprise qui nous emploie, qui nous incite à nous lever le matin pour accomplir nos tâches sociales, à faire des efforts pour satisfaire nos employeurs. Cependant, et c’est là ce qui intéresse Frédéric Lordon, la balance affective qui nous incline à l’obéissance n’a rien d’immuable : « Rien n’exclut que les balances affectives puissent être modifiées. » Le « cumul d’affects tristes en longue période » peut faire « passer un nombre suffisant de sujets à leur point d’intolérable ». Si les structures se rendent odieuses aux individus, le corps affecté qui y trouvait son compte finit par se rebiffer et s’indigne. Que cette « indignation » électrise un plus large groupe d’indvidus et la société tremble.Croisant sur plus de deux cents pages le structuralisme de Lévi-Strauss et la théorie des affects de Spinoza, Lordon ne fait donc pas l’éloge de la passivité collective. Dans les affects, il observe plutôt de véritables garde-fous à l’abus de pouvoir. S’ils sont le liant des structures d’autorité, ils constituent aussi la seule force à même de renverser ces dernières quand les rapports de force deviennent intolérables.La vitalité néocapitaliste nous fascine et a sans doute encore de beaux jours devant elle, mais sommes-nous prêts, nous, humbles corps affectés, à nous laisser dévorer par elle ? À lire aussi :Et le marché devint roi. Essai sur l’éthique du capitalisme d'Olivier GrenouilleauUne histoire du capitalisme qui refuse d’en faire une évolution « naturelle » de la société, en relatant toutes les contingences de son origine et de son développement : clair, pédagogique et engagé. Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketti Au XXe siècle, on le sait, le capitalisme a traversé des moments prospères : les Trentes Glorieuses en tête nous ont offert l’image d’une accumulation fondée sur l’épargne méritante issue des revenus et nous ont temporairement donné l’illusion d’un dépassement structurel du capitalisme. C’était sans compter le rôle économique joué à chaque fois par les guerres… Pour que le XXIe siècle invente un dépassement à la fois plus pacifique et plus durable du capitalisme, il faut donc se demander pour de bon si nous pouvons attendre de ce « système » autre chose qu’une amplification exponentielle des inégalités.

En cette rentrée, je pense à un certain été 2005. Un été dont mes souvenirs, sans importance, sont désormais recouverts par la mémoire d’un autre : Boris Razon, brillant sujet promis à un bel avenir. Cet été 2005, il a traversé les enfers. De cet au…
Penser le néocapitalisme : vie, capital et aliénation
Publié leLénine voyait dans l’impérialisme le stade ultime du capitalisme. Voici venu le stade cosmétique qui s’empare de nos affects comme de nouveaux objets d’échange. Jusqu’au jour où nos corps, emplis de passions tristes, se retourneront contre lui. Qui a dit que le capitalisme était un système mortifère, un grand absolu inerte, réprimant toute vie dans la logique mécanique du marché ? Pour qui observe le capitalisme contemporain ou « néocapitalisme », la métaphore de la « cage d’acier » qu’employa Max Weber en son temps pour le décrire apparaît obsolète. Le « style » du capitalisme – c’est le constat de départ de Stéphane Haber – est plus proche aujourd’hui de la plasticité du vivant que de la rigidité du mort. Regardez comme il ondule sous nos yeux, comme il nous fascine et nous ressemble, imprimant sa forme, son style expansif et sa vitalité aux domaines les plus intimes de nos vies, et a priori les plus éloignés de ses prérogatives, jusque dans nos usages du bonheur et de l’amour même. On cote sur Facebook la popularité des individus par des « J’aime » comme on cote les entreprises en Bourse ; notre idéal de sérénité inclut des critères d’épanouissement et de compétitivité issus du management. D’une vitalité expansive, protéiforme, le néocapitalisme est aussi le terreau de singularités caractéristiques de sa tendance inhérente à la prolifération, que Stéphane Haber appelle des « puissances détachées », et dont les grandes entreprises multinationales ou le « monde de la finance » sont des avatars à la fois fantasmatiques et bien réels. Véritables excroissances de la vitalité capitaliste, ces puissances détachées prennent peu à peu leur autonomie par rapport aux pratiques humaines dont elles émanent (le travail, l’échange) dans un élan qui ne paraît plus viser que leur « reproduction élargie », incontrôlée, à part, indifférente aux besoins effectifs des individus.« Ne sommes-nous pas les jouets de l’élan expansionniste de ces puissances ? »Sans préjuger de la nécessaire absurdité de leur fonctionnement, Haber s’interroge : n’y a-t-il pas, malgré l’apparente logique d’épanouissement que suggère cette remarquable « vitalité » du capitalisme, une possible « contradiction entre deux formes de vitalités », celle du système et celle des individus ? Quand les grandes agences de notation comme Standard & Poor’s ou Fitch semblent décider à elles seules de la santé économique d’un pays, quand les bénéfices d’une délocalisation pour les entreprises priment sur l’emploi local, ne sommes-nous pas les jouets de l’élan expansionniste de ces puissances ? Et cela au point de ressentir une nouvelle forme d’aliénation, qui n’est plus celle de nos vies dans le monde mort des objets mais de nos vies dans la vitalité des puissances détachées ? Sous l’impact de plus en plus impérieux, parfois très original et sophistiqué de telles puissances, certains aspects apparemment supportables de la vitalité capitaliste pourraient bien finir par devenir progressivement intolérables (le léger malaise que commence à susciter notre dépendance aux nouvelles technologies numériques illustrerait bien ce genre de transition).Du supportable à l’intolérable, il n’y a, du reste, qu’un pas, que permettent de franchir les affects, comme le défend Frédéric Lordon dans son dernier ouvrage. Il pourrait bien arriver un moment où la « vitalité » capitaliste ne donnera plus, passionnellement, aucune raison de souscrire à ses lois. Or cette validation passionnelle est indispensable à la « légitimité » des grandes structures qui quadrillent la société : c’est elle, à terme, qui fonde la légitimité des institutions, de l’école, du tribunal ou de l’entreprise qui nous emploie, qui nous incite à nous lever le matin pour accomplir nos tâches sociales, à faire des efforts pour satisfaire nos employeurs. Cependant, et c’est là ce qui intéresse Frédéric Lordon, la balance affective qui nous incline à l’obéissance n’a rien d’immuable : « Rien n’exclut que les balances affectives puissent être modifiées. » Le « cumul d’affects tristes en longue période » peut faire « passer un nombre suffisant de sujets à leur point d’intolérable ». Si les structures se rendent odieuses aux individus, le corps affecté qui y trouvait son compte finit par se rebiffer et s’indigne. Que cette « indignation » électrise un plus large groupe d’indvidus et la société tremble.Croisant sur plus de deux cents pages le structuralisme de Lévi-Strauss et la théorie des affects de Spinoza, Lordon ne fait donc pas l’éloge de la passivité collective. Dans les affects, il observe plutôt de véritables garde-fous à l’abus de pouvoir. S’ils sont le liant des structures d’autorité, ils constituent aussi la seule force à même de renverser ces dernières quand les rapports de force deviennent intolérables.La vitalité néocapitaliste nous fascine et a sans doute encore de beaux jours devant elle, mais sommes-nous prêts, nous, humbles corps affectés, à nous laisser dévorer par elle ? À lire aussi :Et le marché devint roi. Essai sur l’éthique du capitalisme d'Olivier GrenouilleauUne histoire du capitalisme qui refuse d’en faire une évolution « naturelle » de la société, en relatant toutes les contingences de son origine et de son développement : clair, pédagogique et engagé. Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketti Au XXe siècle, on le sait, le capitalisme a traversé des moments prospères : les Trentes Glorieuses en tête nous ont offert l’image d’une accumulation fondée sur l’épargne méritante issue des revenus et nous ont temporairement donné l’illusion d’un dépassement structurel du capitalisme. C’était sans compter le rôle économique joué à chaque fois par les guerres… Pour que le XXIe siècle invente un dépassement à la fois plus pacifique et plus durable du capitalisme, il faut donc se demander pour de bon si nous pouvons attendre de ce « système » autre chose qu’une amplification exponentielle des inégalités.

Et le marché devint roi
Publié leUne histoire du capitalisme qui refuse d’en faire une évolution « naturelle » de la société, en relatant toutes les contingences de son origine et de son développement : clair, pédagogique et engagé.

Le capital au XXIe siècle
Publié leAu XXe siècle, on le sait, le capitalisme a traversé des moments prospères : les Trentes Glorieuses en tête nous ont offert l’image d’une accumulation fondée sur l’épargne méritante issue des revenus et nous ont temporairement donné l’illusion d’un dépassement structurel du capitalisme. C’était sans compter le rôle économique joué à chaque fois par les guerres… Pour que le XXIe siècle invente un dépassement à la fois plus pacifique et plus durable du capitalisme, il faut donc se demander pour de bon si nous pouvons attendre de ce « système » autre chose qu’une amplification exponentielle des inégalités.

Le charme des penseurs tristes
Publié lePlutôt que de « penseurs tristes », il s’agit de « penseurs qui attristent », qui attristent ceux qui tiennent trop à leurs illusions vitales. Bien sûr, la plupart des auteurs qu’évoque Frédéric Schiffter ne font pas mystère de leurs humeurs : La Rochefoucauld évoque sa mélancolie, la marquise du Deffand son cafard, Cioran ses insomnies, Albert Caraco son dégoût. Mais la tristesse n’est pas une pensée, plutôt un vide qui appelle une mise en mots et en concepts plus inventive. Le charme de ce court livre, qui n’est pas triste, est de nous transmettre la jubilation de ces entreprises de démolition. Le penseur et le moraliste évitent l’esprit de système qui plaît tant au philosophe. Plutôt que de s’épuiser en démonstrations, ils s’adressent à ceux qui ont déjà compris. Ils peuvent donc s’adonner aux joies de la forme brève et, sur les ruines de la croyance la plus élémentaire en soi-même, faire jaillir une étincelle dans le langage. La jouissance de la forme et la probité de la démarche : telles sont les dernières valeurs de ceux qui ne souscrivent plus à aucune. « L’honnêteté du penseur ne consiste pas à édifier les hommes mais à les démoraliser tant leur vice le plus funeste est de croire en eux-mêmes », écrit Schiffter. De l’Ecclésiaste à Roland Jaccard, on trouve un air de famille à cette lignée de profonds sceptiques, ce qui corrobore leur thèse favorite du perpétuel recommencement. Seule l’intrusion de Socrate, en ouverture, aurait mérité quelques éclaircissements.

Faillir être flingué
Publié leÀ première vue, ils sont en route vers une ville naissante quelque part dans le grand Ouest américain. Perdus dans l’immensité, ils semblent ne plus aller nulle part, le trajet lui-même devient leur territoire. Ce sont des êtres en perpétuel mouvement, modelés par l’espace infini et la nature imprévisible. C’est ainsi que Céline Minard raconte ses personnages de Far West : les frères McPherson qui avancent avec leur mère mourante tirés par des bœufs opiniâtres, Arcadia Craig, la contrebassiste itinérante qui s’est fait dérober son archet par une bande sans foi ni loi, Elie, poursuivi sans trêve par Bird Boisverd dont il a volé le hongre pommelé, Gifford qui réchappe de la variole et se promène quasi nu dans la grande prairie, ou encore Eau-qui-court-sur-la-plaine, une Indienne guérisseuse dont le clan a été décimé. Pour eux, les pistes sont chargées de signes, l’espace est un texte infini. Et lorsqu’ils se croisent, c’est comme une rencontre de champs magnétiques, il en sort d’étranges lueurs, de surprenantes trouvailles poétiques ou burlesques. À mesure qu’ils se rapprochent de la ville, le lien se resserre entre ces coureurs solitaires. Bientôt, ce ne seront plus que d’honnêtes commerçants, des piliers de saloon, de puissantes matrones ou de sympathiques escrocs. La vie citadine transforme leur goût de l’errance en passion du jeu. La fondation d’une ville repose toujours sur un meurtre : ici, de façon diffuse, c’est celui des peuples indiens, lentement dépossédés et exterminés.« Céline Minard ouvre violemment le champ de nos perceptions »Depuis R (Comp’Act, 2004) et La Manadologie (Éd. MF, 2005), Céline Minard mène une entreprise littéraire sans équivalent. Brassant les langages et détournant les genres, de la science-fiction au manga en passant par le roman historique et la pensée leibnizienne, elle parvient à repousser les limites du possible tout lui conservant des allures naturelles. Dans ce western inclassable qu’est Faillir être flingué, il ne s’agit pas de fantastique mais plutôt d’un réalisme aux frontières abolies. L’immensité poreuse du Grand Ouest change notre perception du temps. Un personnage s’égare dans une tribu indienne, un autre est prêt à tuer pour un archet de violon. Céline Minard ouvre violemment le champ de nos perceptions. Elle sait raconter de l’intérieur la course incontrôlable d’une horde de trois cents chevaux sauvages, leur grâce et leur fougue sans origine ni but, ce qui résume le plaisir de lecture qu’elle nous donne.

L'évènement Socrate
Publié leSocrate est condamné par les Athéniens à boire la ciguë en 399 avant notre ère : un événement fondateur sans cesse rejoué et réécrit. Derrière l’image d’Épinal d’un philosophe libre penseur injustement mis à mort, que se cache-t-il ? C’est l’objet du travail de Paulin Ismard. Plus qu’un fait historique, le procès de Socrate se présente à l’historien comme un « laboratoire », une « coupe géologique » où se lit d’abord la fonctionnement de la démocratie athénienne des Ve et IVe siècles avant J.-C. Avec l’accusé Socrate, l’exercice de la justice devient acte politique : à force de questions, l’enseignement du philosophe menace la cohésion d’une cité affaiblie par la guerre du Péloponnèse. La lecture n’est cependant pas aisée tant la « chimère » Socrate se dérobe – « Platon par devant, Platon par derrière », écrit Nietzsche.D’un dialogue apologétique à l’autre, la figure de celui que l’on accuse d’impiété et de corruption de la jeunesse se brouille. Ismard identifie plusieurs visages qui construisent un mythe. Ennemi de la démocratie proche des oligarques, premier martyr chrétien, puis intellectuel engagé défenseur de la liberté d’expression, Socrate prend les contours d’une modernité qui se construit avec pour modèle la Grèce antique. Le régime qui le condamne porte, d’après Tocqueville, débordements et nivellement par le bas. Mais à bien y regarder souligne Ismard, notre système géré par des experts ressemble fort à l’oligarchie détestée des Athéniens. Quand celle-ci passe pour démocratie, un remède traverse les siècles : la sage ironie socratique.

La fable mystique, 1 : XVIe - XVIIe siècle
Publié leEn 1982, l’historien et philosophe Michel de Certeau publiait son dernier grand œuvre, La Fable mystique, une fascinante plongée dans les écrits et les expériences de ceux qui touchent à l’ineffable… et comment ils ont été reçus (fous, sages, saints, idiots, hystériques, poètes surtout…). Se révèle, dans le phénomène mystique observé notamment aux XVIe et XVIIe siècles, la « relation pathologique qu’une société entretient avec elle-même ». Michel de Certeau travaillait d’arrache-pied à ce second tome quand il est mort, en 1986. Avec exigence et modestie, Luce Giard, qui veille à l’édition posthume de son œuvre, n’a pu que, patiemment, en composer un genre de « bâti » comme on dit en couture, en réunissant, selon les plans que l’auteur avait laissés, des articles édités de façon éparse comme autant d’esquisses des futurs chapitres. Seule une longue étude sur Nicolas de Cues (1401-1464) est inédite, où la profondeur de Certeau trouve à s’exercer. Il pénètre dans le regard du théologien allemand qui fut, comme lui, si proche de l’expérience mystique, y reconnaissant cet « éblouissement au cœur du non-savoir », cet éclair de ce qu’il appelle « la docte ignorance » comme mode de la connaissance scientifique. De même, le jésuite Certeau replace ici, dans une prose érudite et sensible, la mystique dans le champ scientifique. « La mystique n’est pas de l’extraordinaire ou du bizarre, écrit-il, mais de l’essentiel. » Car s’y joue, non seulement une prise de parole pour « faire avouer aux mots de ce qu’ils ne peuvent pas dire », mais un désir absolu d’une relation à l’Autre, toujours manquant.

Faber: Le destructeur
Publié leQue faire quand la société ne tient plus ses promesses d’émancipation ? L’insurrection a-t-elle encore un sens ? Comment la protéger de sa part narcissique et dévastatrice ? Telles sont les questions qui courent tout au long de Faber. Dans l’enfance et l’adolescence, Madeleine et Basile ont subi l’ascendant irrésistible du jeune Mehdi, alias Faber, orphelin surdoué élevé à l’assistance publique. Protecteur et manipulateur d’une précocité inquiétante, Faber a lentement consolidé son emprise sur ses condisciples et leur famille. Attiré par l’ultragauche, meneur de grève lycéenne, justicier et meurtrier, il se retrouve happé par l’aventure politique radicale. Mais la violence qui sourd en lui n’est pas tant liée à l’idéologie qu’à une sorte d’ascèse négative, autodestructrice.Figure à la fois messianique et démoniaque, quelque part entre Thomas l’obscur de Maurice Blanchot et Netchaïev, le terroriste russe qui inspira les Possédés de Dostoïevski, Faber ne se réduit pas à un personnage de notre actualité. Dans la platitude du paysage urbain, dans les méandres désenchantés du lien amoureux, Tristan Garcia excelle à nous faire toucher du doigt un univers sans rédemption possible. Un monde d’extinction lente où le temps des prophètes n’est pas encore venu. Ne reste alors que la fascination d’une intelligence hors norme, aussi profondément hantée que banalement paranoïaque, racontée de l’intérieur dans un vide qui ne cesse de croître.

L'Etat du Ciel
Publié leAu Ciel, ça ne va pas fort. Depuis que Dieu est mort, ou qu’il soigne sa nausée en dormant le nez contre le mur du néant, les anges s’ennuient et ne peuvent plus grand-chose pour les mortels. Raphaël voudrait tout de même trouver un petit miracle à accomplir. L’ange choisit de passer dans la vie de Nora, artiste peintre qui s’enfonce dans un désespoir mortifère depuis la disparition de son fils. De cet argument naïf, qui rappelle beaucoup La vie est belle, du cinéaste Frank Capra, Pierre Péju offre un conte moderne en mode mineur, sans Dieu ni Diable, sur la souffrance humaine. Son Raphaël a un côté aristo désargenté. Il n’est pas aussi croyant que le brave Clarence de Capra, honnête travailleur du Ciel… Ce serait plutôt l’histoire bienheureuse de la chute de l’ange où la rédemption se joue à ras de terre et a, comme souvent chez Péju, l’enfance comme seul miracle.

Dictionnaire philosophique
Publié leCe dictionnaire est un monument qui serait familier. Imposant, il n’intimide pas. Il faut dire qu’on peut y entrer de mille six cents façons différentes. Malgré la compétence reconnue de son unique architecte et bâtisseur, l’édifice évoque donc moins Versailles que le Palais idéal de Ferdinand Cheval. C’est ce qui fait – outre qu’on y apprend énormément – son charme un peu dingue. C’est l’œuvre d’une vie. Comme le facteur bourrait ses poches de petits cailloux lors de ses tournées, des années durant, on imagine le philosophe revenir d’une conférence avec une remarque étonnante, d’un déjeuner amical avec une anecdote, d’une promenade avec une pensée. Il ne se prive pas de les restituer. Il complète d’un bon tiers la première édition de ce dictionnaire, datant de 2001.«Un bric-à-brac d’autant plus philosophique qu’il est antisystématique»Cheval s’inspirait du Larousse pour mieux en pervertir les images. Comte-Sponville, lui, reprend les entrées de deux dictionnaires philosophiques célèbres, ceux de Voltaire (1694-1778) et d’Alain (1868-1951, auteur des Définitions). Mais il en triture lui aussi le sens. Quand Voltaire tape sur les abbés qu’il accuse de piller le peuple, l’athée spiritualiste les défend : « Rencontrer un abbé, aujourd’hui, même pour le libre penseur que je suis, c’est plutôt une bonne surprise. » Il se permet même de brillamment réinventer la liste des péchés capitaux. Ce qui donne : égoïsme, cruauté, lâcheté, mauvaise foi, suffisance, fanatisme, veulerie. Ajoutons les termes les plus techniques du vocabulaire philosophique – « amphibologie », « téléologie », « contingence » —, expliqués avec rigueur et clarté (mais avec un éclairage spinoziste assumé), mêlons-y des termes du langage courant (« élégance », « douceur »…), quelques néologismes (« duration », « éternullité »), des notions de pensée asiatique (« samsara », « wuwei ») des clichés de notre époque (« vraies gens », « beaufitude »), et voici un bric-à-brac d’autant plus philosophique, d’après son auteur, qu’il est antisystématique. Le tout est traité sans affectation, avec une familiarité qui nous implique dans la réflexion sans nous emprisonner.Mais si l’on observe les notions ajoutées par l’auteur depuis douze ans, on lit l’évolution de son regard sur notre époque. Sont-ce les années Sarkozy qui l’ont poussé à ajouter « césarisme », « charisme » et « populisme » ? Est-ce la résurgence de l’antisémitisme qui le pousse à le réfuter avec rigueur ? Les notions liées à la bioéthique, à la catastrophe écologique, à l’argent, à l’économie, à la mondialisation abondent dans cette nouvelle version, en réponse aux interrogations du temps. Mais ce sont deux nouvelles entrées qui évoquent le mieux ce qui a changé, pour lui, depuis le 11 septembre 2001. Outre un hommage à l’adolescence (« On est beaucoup plus beau qu’on ne le croit (surtout les filles), un peu moins intelligent qu’on ne l’imagine […]. On ne comprendra que beaucoup plus tard que c’est durant ces années-là – du moins c’est le sentiment que j’ai – que, sans le savoir, on s’est trouvé »), le néologisme « adulescent » ne passe pas inaperçu. Le phénomène de ces adultes qui ne veulent pas grandir « trahit quelque chose de notre époque, de son jeunisme stupide, de la dureté du monde économique, de la douceur, parfois piégeante, du cocon familial ou amical. Peur de grandir chez les uns, peur de vieillir chez les autres, peur, chez presque tous, du chômage, de la misère, de l’exclusion, de la solitude, de l’abandon… Difficile, avec tant de peurs, de prendre sa vie en main ». Si nous avons sombré dans la peur, ce dictionnaire est justement écrit, non pour nous consoler avec de bonnes paroles, mais, dans l’esprit de Spinoza, pour nous rendre plus lucides. La visite s’impose, non ?

Qu'est-ce que la subjectivité ?
Publié le« Le problème qui nous intéresse, c’est le problème de la subjectivité dans le cadre de la philosophie marxiste. » Nous sommes prévenus : dans cette conférence donnée à Rome en 1961, devant les intellectuels communistes de l’Institut Gramsci, Sartre voit rouge. Pour ce compagnon de route iconoclaste, qui vient de publier la Critique de la raison dialectique, l’individu ne peut plus être pensé comme une pure conscience : enracinée dans le social, comme l’avait bien compris Marx, « la subjectivité est dehors ». Dans la vie concrète plus que dans une conscience de classe abstraite, tonne le philosophe, qui règle ici ses comptes avec Georg Lukács : ce grand maître à penser du marxisme voyait dans l’existentialisme sartrien une pensée bourgeoise…Au-delà du témoignage sur la vie intellectuelle de l’époque, il y a dans cette harangue sur la subjectivité un souffle inimitable, qui retrace toute la complexité d’être soi. C’est-à-dire d’être « un tout en perpétuel totalisation », qui se projette parce qu’il intériorise et qui s’invente en s’ignorant. Car c’est dans le « non-savoir » que la subjectivation trouve sa source. Ainsi en va-t-il du chef-d’œuvre de Gustave Flaubert, qui le révèle comme sujet à travers une description objective de la société de son temps : un obscur rapport à soi dont il ne prendra conscience qu’après coup, en déclarant « madame Bovary c’est moi ». Sartre, lui, travaillera encore près de dix ans sur L’Idiot de la famille, l’énorme ouvrage qu’il a consacré au romancier : dans cette conférence plus troublante qu’il n’y paraît, la rhétorique militante se lézarde en un savant jeu de miroirs où le philosophe révèle aussi sa propre subjectivité.
Etre et sexuation
Publié le1. Le sexe de l’être…Certaines métaphysiques viennent-elles de Mars et d’autres de Vénus ? Oui, soutient Mehdi Belhaj Kacem (dit MBK), l’ontologie – le discours sur l’être – peut être sexuée. Une pensée masculine promeut une vision immuable et statique de ce qui est, tandis qu’une métaphysique féminine insiste sur ses métamorphoses incessantes. Soit deux exemples : Badiou – ex-maître de MBK – est un philosophe viril, car, chez lui, l’être est inerte, impassible, seulement fendu par un événement foudroyant. A contrario, Deleuze développe une conception « rapide » de l’être, tourbillon de devenirs soudain figé par un événement « lent » ; c’est un métaphysicien féminin. Un prisme iconoclaste, donc, pour revisiter l’histoire de la pensée. 2. … et l’être du sexeMBK ne se contente pas de « sexuer » les ontologies ; il élabore une métaphysique de la sexuation, de la constitution du genre. Cette notion relève de l’identification à un pôle symbolique (masculin ou féminin) et se distingue de l’appartenance biologique à un sexe. Selon le philosophe, la position féminine – et le type de libido qui l’accompagne – se différencie radicalement de la masculine ; elle se définit par « l’identité du désir et de la jouissance ». Tout se fonde sur le modèle du « rut » chez les mammifères (où la femelle entre en transe avant le coït, visée ultime du mâle) dont la sexualité humaine n’est qu’une « parodie », une imitation sophistiquée. Bref, chassez le naturel (par le symbolique), il revient au galop. 3. Un nouveau féminisme ? La cible est clairement le « phallo(go)centrisme » – terme forgé par Derrida pour désigner le primat de la parole masculine dans la métaphysique occidentale. Les relents de « machisme transcendantal » sont stigmatisés, de Lacan à Badiou. L’argument de MBK pour (re)valoriser le féminin ? Selon lui, il subvertit les oppositions traditionnelles en réalisant l’identité de ce que le masculin sépare violemment : l’être et l’apparaître, la vérité et le mensonge… Las, les clichés ont la vie dure : le pop philosophe verse souvent dans des considérations générales sur l’homme insatiable prédateur et la femme bavarde, de sensibilité artistique, plus proche de la nature car enfantant, etc. L’arroseur en est presque arrosé. On l’aura compris : un livre clivant.

Toucher le monde - Pour une architecture sensible
Publié leEn théorie, nous sommes (presque) tous d’accord : le dualisme cartésien opposant le corps et l’esprit, c’est mal. Mais d’un point vue pratique, est-on vraiment sûr que le principe d’un corps connaissant – tel qu’il a été porté par les artistes et les philosophes du XXe siècle – ait été entendu ? À voir nos « pratiques culturelles, éducatives, et sociales », rien n’est moins sûr, affirme avec une ferme douceur Juhani Pallasmaa. S’appuyant sur sa propre pratique, et de nombreux témoignages d’artistes, tel le dessinateur Joseph Brodsky, de philosophes, tel Merleau-Ponty, ou de scientifiques, tel le neurobiologiste Frank R. Wilson, l’architecte finlandais se livre à une précieuse description phénoménologique de « la main qui pense » et crée. Il rappelle ainsi que si l’homme est l’animal qui explore et façonne de nouveaux mondes, c’est à sa main qu’il le doit. C’est elle qui « enregistre et mesure la pulsation de la réalité vécue » : loin d’exécuter « docilement » les desiderata du cerveau, elle « possède une intentionnalité, un savoir et un savoir-faire qui lui sont propres ». Et s’il y avait plus d’un lien entre l’actuel retrait de la main au profit des ordis et la désorientation croissante de nos existences ?

La Dépensée
Publié leUne chose est sûre, Gisèle Berkman n’a pas la plume dans sa poche. « Nous sommes en état de guerre », tempête-t-elle. Contre quoi ? Les neurosciences qui identifient pensée et cerveau, tout en éludant l’immatérialité de la conscience. Or, objecte-t-elle en citant Paul Ricoeur, « la conscience n’est pas une boîte dans laquelle il y aurait des objets ». Berkman joue la phénoménologie et ses notions d’intentionnalité (la conscience est toujours conscience de quelque chose), de pour-soi et d’en-soi, contre l’arsenal des IRM et autres protocoles expérimentaux qui risquent paradoxalement de faire du cerveau un « nouvel impensé ». Du terrain de la recherche, la guerre se poursuit à celui de l’enseignement. L’inspection académique prétend que « le temps des savoirs est terminé, et que nous sommes aujourd’hui à l’époque des compétences » : Berkman oppose à ce mécanisme de « dé-pensée » une « faculté d’aimer », objet réel de la transmission du professeur à l’élève. Un amour sans lequel la pensée se vide de tout objet et de toute substance.« A l’ère de la connification généralisée » où l’expertise règne contre l’analyse, il s’agit de relancer la pensée critique, de s’interroger sur de « nouvelles Lumières critiques pour notre présent ». En s’appuyant sur la psychanalyse et la phénoménologie tout un multipliant les (parfois trop) nombreuses références (Blanchot, Adorno, Freud, Artaud, Derrida… parfois bousculés en un seul paragraphe), Berkman encourage une activité qui ne trouve son réel épanouissement que dans la communauté et l’interdisciplinarité. Et de citer en exemple le Collège international de philosophie… dont elle est membre. « Penser vraiment, c’est toujours, en quelque sorte, penser aux limites » mais aussi « penser sans compter », affirme-t-elle et s’il lui arrive de se perdre en vindictes, son appel a le mérite de ne pas laisser indifférent. En guerre, il faut après tout bien choisir son camp.

Tests & jeux
Nous sommes en 2063, et vous visitez une ferme génétique qui développe de nouvelles espèces d’animaux. Au milieu de votre parcours, une sorte de grand bœuf…

Que représente ce dessin ?1. Un objet impossible dans un espace à trois dimensions2. Un hypercube dans un espace à quatre dimensions3. Une maquette du…

Questionnaire de Socrate
En vingt-cinq ans, le groupe Texas a vendu plus de 30 millions de disques tout en restant une histoire de potes et de pop taillée dans le roc(k). On pensait tout ça fini après les deux aventures en solo de Sharleen Spiteri, chanteuse et…