Et si on apprenait autrement ?
Numéro 172 - Septembre 2023Nous sommes désormais appelés à apprendre tout au long de notre existence. Mais comment canaliser notre curiosité et nous orienter à une époque où, dans tous les domaines, la connaissance excède le temps disponible pour l’assimiler ?
Édito
Bien qu’il en décrive un usage négatif, Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley présente un principe fascinant : l’hypnopédie, soit la possibilité d’apprendre durant son sommeil. Lors d’une visite des installations du Centre d’incubation et de…
Vos questions
Question de Paul Larroumet

Repérages
Avec ses 54 000 mètres carrés de panneaux LED, la façade de The Sphere, salle de spectacle globiforme inaugurée le 4 septembre à Las Vegas, est…

“La priorité, c’est d’assurer le retour à l’ordre républicain” Élisabeth Borne, Première ministre, le 3 juillet 2023, à l’hôtel de Matignon. “La République […], c’est la liberté réciproque, et non pas la liberté qui se limite ; la liberté…
D’où vient la conscience ? Comment est-elle apparue dans l’évolution ? Pour le psychologue Arthur Reber et les biologistes František Baluška et…

C’est le seuil franchi pour la première fois par la température mondiale moyenne le 3 juillet dernier. Ce qui constitue une nouvelle preuve du réchauffement de la planète aux effets dévastateurs. L’Organisation météorologique mondiale a annoncé au…
Perspectives
Après les émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel au début de l’été, le mot « décivilisation » a surgi. L’occasion de se demander…

Comme en témoignent les récentes élections générales, le parti nationaliste Vox obtient de bons scores. Comment comprendre son ascension…

D’origine ukrainienne, l’historien Serhii Plokhy publie début septembre La Guerre russo-ukrainienne aux éditions Gallimard. Il nous explique…

Alors que la France s’apprête à accueillir la Coupe du monde de rugby, des joueurs alertent sur la violence de ce sport, parfois mortel. Cette…

Au fil d’une idée
Parmi les plus anciennes bibliothèques du monde, la girginakku assyrienne, fondée par le roi Assurbanipal dans sa capitale Ninive, disposait, il y a 26 …
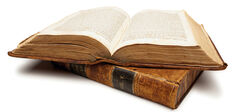
Ethnomythologies
Cette diète numérique promet aux jeunes accros aux réseaux sociaux de décrocher en les privant de dopamine, l’« hormone du plaisir »…

Dialogue
Alors que nos démocraties traversent une crise de représentation et que les inégalités se creusent, que l’organisation du travail est bouleversée…

Portfolio
Si les concepts de réchauffement climatique ou de crise écologique peuvent sembler abstraits ou écrasants, la photographie permet de les rendre…

L’œil de la sorcière
Sollicités en permanence, nous traitons parfois autrui comme un spam. Mais est-ce notre lâcheté ou notre environnement numérique qui nous fait…

Dossier
Et si on apprenait autrement ?
Publié leQu’il s’agisse de découvrir la cuisine ou la meilleure manière de cultiver des tomates à travers des tutoriels en ligne, d’approfondir ses connaissances en diététique ou en musculation grâce à un podcast ou à un coach en salle de sport, ou tout simplement de manier une nouvelle technologie au travail, nous sommes appelés à apprendre tout au long de notre existence, dans des contextes non scolaires. Mais comment canaliser notre curiosité et nous orienter à une époque où, dans tous les domaines, la connaissance excède le temps disponible pour l’assimiler ? En explorant trois voies. > D’abord, la voie de la pratique : des applications aux séances de méditation en passant par le Wwoofing, les moyens d’initiation se sont démultipliés, utilisant des principes que les philosophes du passé ont déjà mis en évidence, comme la « mimétique » chère à Aristote ou le contact direct avec le monde prôné par Jean-Jacques Rousseau. > « Learning by doing », c’est en faisant qu’on apprend. Ce précepte simple est au cœur de la pédagogie du philosophe pragmatiste américain John Dewey, que nous présente Emmanuelle Rozier. > Ensuite, la voie de la pensée. Pionnier de la philosophie pour enfants, Matthew Lipman proposait de cultiver les « habiletés de pensée », comme la capacité à produire une analogie, un contre-exemple ou une déduction. Une piste qui donne le primat à la réflexion sur le savoir et que reprennent aujourd’hui les philosophes Samuel Nepton et Normand Baillargeon, ainsi que le psychologue Albert Moukheiber. > Enfin, la voie de la technique. L’omniprésence des écrans invite à s’interroger sur l’avenir de la lecture profonde et de l’écriture manuelle. Ce que nous faisons en compagnie des neuroscientifiques Maryanne Wolf et Jean-Luc Velay, ainsi que de la romancière et « bibliothérapeute » Régine Detambel. > Et maintenant, un peu de prospective : comment l’apprentissage va-t-il se métamorphoser au XXIe siècle ? L’arrivée de ChatGPT et des IA génératives doit-elle nous faire réviser nos méthodes ? Pour tenter d’imaginer le futur, la linguiste et informaticienne Justine Cassell dialogue avec le chercheur en sciences de l’éducation François Taddei.

Qui n’a jamais rêvé d’être un puits de science ? D’être quelqu’un de complet, c’est-à-dire d’avoir des connaissances de base dans tous les…

Plus forcément besoin de s’inscrire à des cours pour apprendre une langue, se mettre au jardinage ou bricoler. Il suffit d’ouvrir une application…

Learning by doing, « on apprend en faisant » : tout le monde a déjà entendu l’expression, mais on sait moins que sa popularité…

Pédagogues, philosophes et psychologues s’accordent aujourd’hui pour dire que bien raisonner est moins une affaire de connaissances que d…

Désormais, c’est de plus en plus sur smartphones, ordinateurs et tablettes que nous faisons l’expérience de la lecture et de l’écriture…

La linguiste Justine Cassell, devenue spécialiste de l’intelligence artificielle, et le généticien François Taddei, devenu chercheur en sciences…

Entretien
Alors que la dignité est invoquée comme un grand principe dans nos démocraties, partout – de l’école aux réseaux sociaux –, les…

L’aventure d’un classique
“Tristes tropiques” : Lévi-Strauss au cœur de l’humanité
Publié leLe récit d’un voyage ? Un travail ethnologique de terrain ? Une autobiographie intellectuelle ? Un journal philosophique ? Une œuvre littéraire ? Un essai en forme de bilan de la civilisation occidentale ? Les ambivalences de Tristes Tropiques sont à l’image de la personnalité de son auteur, Claude Lévi-Strauss : riche et complexe.

Le récit d’un voyage ? Un travail ethnologique de terrain ? Une autobiographie intellectuelle ? Un journal philosophique ? Une…

À travers la redéfinition de concepts classiques, Claude Lévi-Strauss renouvelle notre regard sur les sociétés humaines en général et sur la civilisation occidentale en particulier.
Dans la conclusion de sa leçon inaugurale au Collège de France, le 5 janvier 1960, Lévi-Strauss justifie la création tardive de la chaire d’anthropologie sociale et, se demandant si elle n’est pas une « séquelle du…
Pour ce spécialiste de Claude Lévi-Strauss, l’auteur de Tristes Tropiques fonde moins sa réflexion sur l’alternative entre universalisme et…
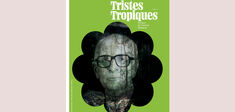
Boîte à outils
C’est un leitmotiv auquel chaque génération s’accroche… Mais pourquoi cette conviction passéiste nous poursuit-t-elle ? Quatre philosophes…

Livres
Peut-on raconter une histoire en perspective ? Et comment fait-on pour importer, tant dans la forme que dans le fond, cet artifice pictural inventé par les maîtres de la Renaissance ? Tel est le défi relevé par Laurent Binet, dans son…
L’Ère du toxique
Publié le« Le goût de tes lèvres, ça me fait grimper au rideau / Tu es toxique, je défaille / Avec un goût de paradis empoisonné / Je suis accro à toi / Ne sais-tu pas que tu es toxique ? » chantait Britney Spears en 2003. Si le tube de la pop star connaît depuis quelques années un retour de hype, ce n’est peut-être pas si anodin. Le mot « toxique » est en effet sur toutes les lèvres, au point qu’il semble ironiquement avoir contaminé notre vocabulaire. Une relation amoureuse tourne à la manipulation et à l’emprise ? Toxique. Un patron en réclame toujours plus tout en remettant en question le travail accompli ? Toxique. Un ami ou un parent devient trop envahissant et s’immisce dans chaque recoin de notre vie ? Toxique, encore. En prenant comme point de départ l’omniprésence du toxique pour désigner ce qui force notre psyché en réduisant à néant ses barrières, la psychanalyste Clotilde Leguil relève que nous vivons dans une époque où le risque d’empoisonnement ne concerne plus seulement notre corps mais aussi notre esprit. Quand, en 2021, dans Céder n’est pas consentir (PUF), elle analysait le consentement et ses modalités comme ce qui permet de garder une saine distance avec autrui, l’autrice s’intéresse désormais à ce qui rend les frontières poreuses entre individus qui peuvent dès lors s’infecter psychiquement les uns les autres. Alors que le champ du toxique se limitait auparavant aux substances chimiques, la psychanalyste remarque qu’il concerne désormais les relations interpersonnelles. Étymologiquement, le toxicon désigne en grec le poison dont les soldats enduisaient la pointe de leurs flèches afin de les rendre mortelles à coup sûr. La pratique trouve par ailleurs son origine, non pas chez les Grecs, mais chez ceux qu’ils nommaient « barbares ». Le toxicon vient donc de l’autre, il est une blessure, une ouverture pratiquée par autrui qui lui permet de nous rendre peu à peu étranger à nous-mêmes, parfois jusqu’à la mort. Cette brèche métaphorique est ouverte par le langage : c’est lui qui nous séduit, nous subjugue et nous fait abdiquer toute réserve. À l’appui de sa démonstration, Clotilde Leguil convoque Robert Musil, Gustave Flaubert ou encore le cinéaste David Cronenberg, tous témoins et narrateurs de la toxicité croissante de notre environnement. Qu’arrive-t-il à l’élève Törless pour qu’il consente à assister soir après soir à la torture d’un de ses camarades de promotion, sans jamais protester ? Qu’arrive-t-il à Emma Bovary pour qu’elle finisse par se suicider en avalant de l’arsenic ? Quant aux personnages des Crimes du futur (2022) que Cronenberg met en scène dans une dystopie ironique et hallucinée, sont-ils même encore humains ? Tous sont coupables d’un excès de jouissance, d’une absence de limites. Törless se laisse séduire par le discours de ses camarades et finit par jouir de la souffrance d’autrui, Emma Bovary se gave de romans d’amour et collectionne les amants jusqu’à plus soif, surtout par ennui, et Cronenberg propose une solution en forme de blague : et si nous nous nourrissions de ce qui nous empoisonne, en l’occurrence le plastique ? Le toxique exige toutefois un véritable remède, tant il se répand à la vitesse du vent. Clotilde Leguil suggère de revenir à la fois au désir, qui précède la jouissance, et au langage, qui permet de décrire l’intoxication et ses effets délétères – à la thérapie en somme. Encore faut-il être sûr de ne pas être monté trop haut pour espérer redescendre, comme s’en inquiétait Britney.

Les Heures heureuses
Publié le« Rares les hommes qui ne sont pas pris en otage par le temps métrique et pour ainsi dire pulsatile des portables », écrit Pascal Quignard dans ce douzième tome de Dernier Royaume. Lui qui commença naguère une thèse sur le langage chez Bergson y médite sur la jouissance du temps et ce qui nous en prive. Se rapprocher du pur présent, faire de chaque heure un royaume : ce projet semble à la portée de chacun. Or il exige une conversion permanente. Les habitudes sociales et le langage nous en détournent. L’urgence perpétuelle nous consume. Comment échapper à ce temps stérile, à ce compte à rebours dans lequel nos vies s’épuisent ? L’œuvre de Quignard est placée sous le signe de la rupture. La littérature sauve, dit-il, mais à certaines conditions. Derrière toute parole, il s’agit de retrouver une « hallucination première », un « songe immémorial ». Cette expérience – que Quignard appelle le « jadis » ou « la pulsion inorientée » – nous constitue et nous irrigue. Il faut accueillir en soi le miracle d’un temps qui jaillit de sa source, profus, indivisible et sans destination. L’art d’écrire de Quignard est une fugue. Il se tient sur une crête entre conscience et inconscient, quête de vérité et risque assumé de l’égarement. Il restitue la fraîcheur perdue d’un rythme et d’une vision. Des paysages s’y déploient, depuis l’Yonne jusqu’au Japon. Le temps et l’espace sont retrouvés l’un par l’autre. On y passe des « très riches heures » enluminées de Jean Ier, duc de Berry au XVe siècle, au portrait d’Emmanuèle Bernheim, romancière disparue en 2017 et infatigable nageuse, en passant par La Rochefoucauld, Spinoza ou Sándor Ferenczi, qui, chacun à sa façon, entrèrent en sécession. On y tente enfin, tantôt émerveillé tantôt incrédule, de revenir à une extase élémentaire, antérieure à tout discours.

Love. Histoire d’un sentiment
Publié leQuel rôle joue l’élu de mon cœur dans ma vie ? À quelle fiction, à quel mythe, suis-je en train de m’accrocher quand je vis mes propres histoires d’amour ? C’est au prisme de ces questions existentielles que l’on peut parcourir cette fresque consacrée aux fictions amoureuses, où s’entrelacent des mythes antiques et philosophiques, des chansons grivoises de troubadours, des lettres d’amour ou encore des épitaphes. Barbara H. Rosenwein, historienne médiéviste spécialisée dans l’étude des émotions, organise ses sources en cinq parties, qui sont autant de questions sur les rapports amoureux. Mon amour est-il celui qui me complète, mon alter ego ? Celui qui m’élève et me fait être meilleur, mon maître, voire mon Dieu ? Apparaît-il plus simplement comme mon mari ou ma femme, limitant en partie ma liberté via les liens du mariage ? Prend-il la forme obsessionnelle d’un être qui hante mes pensées ? Peut-être se présente-t-il enfin comme un ensemble de conquêtes, fruits d’un « vagabondage amoureux » ? Cette dernière option, incarnant « la menace d’un désir libéré de ses chaînes » est « le cœur des ténèbres », avertit l’autrice. Si certains récits libertins ont donc été censurés – entre autres sous l’impulsion de l’Église –, ils ont continué à exister de « manière souterraine », alimentant un univers érotique traversé de paradoxes. Ainsi les élèves des sévères écoles médiévales lisaient-ils le poète antique Ovide en latin et son éloge du « simple plaisir de flirter, de coucher, de dépérir de désir », lui qui n’hésitait pas à demander à une femme mariée de venir à un banquet « avant son mari ». Pourquoi ? « Je n’en sais rien, mais viens avant quand même », exigeait-il, badin. Barbara H. Rosenwein s’attaque à un présupposé assez ancré selon lequel les histoires d’amour se diviseraient en deux grands mouvements : un passé fait de contraintes et un présent libéré. Au XIIe siècle, la belle Héloïse, préférant être « la putain » de son amant Abélard plutôt que sa femme, plaide au contraire pour une version très moderne de l’amour, délestée des obligations matrimoniales. Inversement, la vie en ménage telle qu’elle est vécue aujourd’hui – avec, notamment, le poids de la « double journée » des femmes – possède son lot de contraintes et d’inégalités. Enfin, le mariage d’amour, mû par nul autre motif que la pure passion, célébré depuis les années 1960-1970, est en un sens plus exigeant moralement que toutes les autres formes de conjugalité. Sous ses airs libérateurs, il est assorti d’une obligation aussi puissante que paradoxale : celle « de ne pas se sentir obligé », d’agir en étant porté à chaque instant par une passion constante et inextinguible, indépendamment des conditions matérielles d’existence et des fluctuations des sentiments. Même si l’on sait que cet amour absolu est un mythe, on ne peut s’empêcher de s’en servir pour structurer nos espoirs et nos attentes. Il est facile, prévient Rosenwein, « d’adhérer à une fiction et de la laisser dominer sa vie ». Mais le fait de prendre conscience de l’immense diversité des récits sur l’amour et de découvrir les ruptures, les continuités, les résonances, les contradictions de tous ces mythes puissants et foisonnants, permet de se libérer de leur tyrannie.

Plus jamais
Publié leCiaran est beau comme un Dieu, et la narratrice lui voue un culte sans limite. Cet amour proche du fanatisme religieux pour un être jugé supérieur renvoie au mythe d’un amour « transcendant ». L’héroïne le dit elle-même : aimer, c’est prendre « un objet qu’on vise et qui dépasse tous les autres ». Dans les débuts, cette passion transporte, transfigure et porte les amoureux vers le haut. Mais, petit à petit, l’amoureuse se dévalorise, s’efface et se fait du mal. Quand elle en prend conscience, elle éprouve « dans [s]a chair la sensation d’être restée trop longtemps en apnée ». Plus jamais ça !

L’Amour
Publié leElle s’appelle Jeanne, il s’appelle Jacques. « Les copains disent : Jeanne et Jacques. Ils n’ont jamais dit Jacques et Jeanne. Pourquoi dans ce sens et pas dans l’autre ? » On ne sait pas trop, mais c’est ainsi. C’est l’histoire toute simple, toute nue, d’un amour qui suit son cours au fil d’une existence partagée. Ni assiette brisée, ni crise de nerfs, ni violence. Le mariage présente son lot d’obligations et de contraintes quotidiennes, mais peut aussi ouvrir sur une joie pure et paisible, sans perte ni fracas. Cette forme d’amour est une manière de se compléter et de s’accompagner tendrement, sans s’abîmer.

Pauvre Folle
Publié leClotilde et Guillaume sont des littéraires. Ils s’échangent des lettres et fabriquent un monde de mots autour d’eux. Elle y joue « la reine » et lui, « le monstre ». Problème : Clotilde est follement amoureuse de Guillaume qui est homosexuel. Dans un profond déni, elle choisit de ne pas prendre en compte ce paramètre. « Le monstre » l’obsède, la dévore, la consume. Elle se complaît dans cet état, qui renvoie à une forme obsessionnelle, maladive du sentiment amoureux. « Tout ce qui concernait Guillaume, elle l’avait vu, lu, écouté. Les vidéos, en boucle, des heures. » Peut-on – et comment – se sortir d’un amour à sens unique ?

Samsara
Publié leOn confond trop souvent l’épitaphe et l’épigraphe. L’épitaphe est sur la tombe, l’épigraphe en tête de livre (ou du chapitre d’un livre). « Milanese, scrisse, amo, visse » (« Milanais, il a écrit, il a aimé, il a vécu ») : c’est, au cimetière de Montmartre, l’épitaphe de Stendhal, pour qui l’épigraphe « doit augmenter la sensation, l’émotion du lecteur ». Elle peut aussi suggérer le sujet ou l’esprit d’un roman – ou contredire son titre. C’est justement le cas dans le nouveau roman de Patrick Deville. Voici bientôt vingt ans, ce globe-trotteur indécrottable pour qui la rue du Cherche-Midi à Paris est le centre du monde, s’est lancé dans ce qui sans doute est le projet littéraire francophone le plus érudit, le plus foisonnant et le plus ambitieux de ce premier quart de siècle : un cycle de douze romans sans fiction qui revisite l’histoire du monde de 1860 (début de la révolution industrielle) à nos jours, dans une circumnavigation infinie. Il y eut d’abord Pura Vida, autour de la figure d’un aventurier qui caressait le rêve d’un empire centraméricain, puis, entre autres, Peste & Choléra (sur Alexandre Yersin et la bande à Pasteur – son plus grand succès), Viva (on partait pour le Mexique, on y croisait Trotski et Malcolm Lowry), et voici qu’arrive en librairie le neuvième tome du « Projet Abracadabra » : Samsara, soit la grande roue des vies successives à travers la réincarnation. De fait, les deux héros de cette histoire semblent avoir mille vies derrière eux : le pacifique Mohandas Gandhi et le révolutionnaire cosmopolite Pandurang Khankhoje servent de fil rouge à cette déambulation à travers l’Inde et le XXe siècle, sous les auspices d’un jeune Ardennais (Arthur Rimbaud), dans la correspondance de qui Deville est allé puiser l’épigraphe de son livre : « … et heureusement que cette vie est la seule et que cela est évident… ». Mais est-ce bien si évident ? Oui, nous dirait Milan Kundera : « […] C’est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n’est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l’ébauche de quelque chose, la préparation d’un tableau, tandis que l’esquisse qu’est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. » Avec son écriture virtuose et déroutante, Deville vient nuancer le tableau.

Le Marteau brisé de Dante
Publié lePeu connu dans l’Hexagone, Graham Harman, pionnier du « réalisme spéculatif » et fondateur de l’« ontologie orientée objet », est une figure de proue de la philosophie outre-Atlantique. Son ambition est d’échapper à ce qu’on appelle en termes techniques le « corrélationisme » : l’idée qui s’est imposée depuis Kant selon laquelle nous ne nous saisissons toujours des choses qu’à travers notre regard subjectif. Comment donc pourrait-on atteindre l’être en soi, libre de toute représentation, l’absolu ? La première originalité de Harman, c’est d’affirmer que le caractère relationnel de notre compréhension des choses ne vaut pas condamnation au relativisme subjectif. Car la relationalité est une dimension de la réalité elle-même. « Les objets non humains ont […] des relations non pas identiques mais de même nature que celle que nous avons avec eux. […] Le feu “perçoit” le coton » qu’il embrase. Mais Harman ne s’arrête pas là. Si l’objet est en relation sur le plan « sensuel », il « se retire originellement de cette relation » en tant qu’il est en même temps « réel », en tant qu’il existe indépendamment de tout regard. Toute la question est alors celle de l’accès à cet absolu. Et c’est ici qu’intervient Dante et sa philosophie de l’amour universel. Là où la perception et la raison décomposent la chose en une somme d’éléments ou de qualités sensibles, l’amour nous dévoile cette « “force de gravitation” de l’objet réel » indivisible qui « transmet sa marque aux qualités qu’il porte », qui les tient ensemble et les colore d’une manière absolument singulière. « C’est précisément dans cette unicité que se donne à voir l’invisible. » Une proposition métaphysique aussi exigeante que revigorante !

Tout un monde dans une coquille
Publié leCertains s’en souviennent peut-être : en 2019, les médias anglo-saxons, du National Geographic à The Atlantic en passant par CNN, pleuraient la mort de « lonely George », une célébrité d’autant plus étrange qu’elle n’était autre qu’un tout petit escargot élevé en laboratoire. George avait toutefois la particularité d’être le dernier représentant de son espèce, l’Achatinella apexfulva, endémique de l’île hawaïenne d’O‘ahu. Avec lui s’éteignait une espèce victime comme tant d’autres de la modification de son environnement : nouveaux prédateurs introduits par des échanges commerciaux croissants, collectionneurs avides de coquilles au couleurs chatoyantes, diversité moindre des essences qui composent la forêt hawaïenne… La disparition d’A. apexfulva permet de comprendre celles qui se jouent actuellement dans une relative indifférence, notamment parce qu’elles concernent des insectes et des gastéropodes moyennement photogéniques. De même qu’Anna Tsing s’est intéressée au matsutaké, un champignon à l’aise dans les paysages dévastés, pour comprendre la dégradation de nos écosystèmes, Thom Van Dooren se penche sur ces escargots hawaïens pour penser l’extinction de masse. Que signifie la disparition d’un être qui vit non pas dans sa coquille, mais sur le mode de la coquille, c’est-à-dire tantôt enroulé sur lui-même, tantôt déroulé sur le monde ? Et qui fait de la bave un mode de communication ? C’est tout un monde de significations qui s’éteint avec A. apexfulva. Et à plus ou moins long terme, ce sera sûrement à notre tour d’en baver.

Les Chaînes sans fin. Histoire illustrée du tapis roulant
Publié leC’est en tombant en plein Paris sur une agence de pompes funèbres surmontée au premier étage d’un club de fitness où plusieurs silhouettes étaient en train de s’entraîner à petites foulées sur d’indiscernables machines, « purgatoire gymnique où des âmes défuntes joggaient sur place comme en apesanteur », que l’essayiste Yves Pagès s’est décidé à mener cette passionnante enquête sur les origines et l’histoire du tapis roulant. Convaincu que quelque chose de décisif se joue dans cette association entre la mort qui rôde et la course qui bute. Pourquoi désire-t-on aller nulle part au plus vite, se déplacer en faisant du surplace, perdre sa vie à la rattraper ? C’est la question métaphysique qui accompagne cette histoire foisonnante. En s’attardant sur une multitude de techniques déployées depuis le XVIIIe siècle pour faire rouler sur des tapis des animaux, des marchandises et des humains, l’auteur perçoit l’esprit tordu de notre temps, raccordant l’accélération et le surplace, l’inventivité et la stérilité, l’ingéniosité et l’absurde, la vitalité et le morbide. Dans cette drôle d’histoire, jamais documentée jusque-là dans sa globalité, Pagès fait honneur à des ingénieurs au service de l’accélération mécanique des mouvements d’animaux (une course à l’arrêt de chevaux galopant à contre-courant sur un « tablier à chaîne sans fin » motorisé en 1891), de marchandises (le tapis de caisse dans le premier mall des États-Unis en 1955), de voyageurs (depuis le premier « trottoir roulant » installé lors de l’Exposition universelle de Paris en 1900) ou de sportifs, avec à leur tête, dès 1994, l’actrice Jane Fonda, figure maîtresse du fit-business. Avec le tapis de course, « s’expriment tout à la fois le motif sisyphéen de nos servitudes volontaires et l’imminence capitalistique d’un saut... bien au-delà du précipice », écrit Pagès, qui perçoit dans cet appareil la prégnance d’un mot d’ordre : « une croissance illimitée ». Mais il n’invite pas à renoncer au mouvement qui nous emporte sur des tapis de plus en plus sophistiqués. Il s’amuse plutôt à mettre à plat le désir hypnotique des sujets du monde actuel se surmenant en pure perte (de poids). Comme s’il tenait dans cette image d’une course sur place accélérée le symbole de notre soumission et de notre aliénation à la culture de la performance.

Célébration du cogito
Publié le« J’éponge donc j’essuie », « Mojito ergo sum », « Je dépense donc je suis » (signé Descartes de crédit) ou encore « Covido ergo zoom » : on ne compte plus les détournements auxquels la célèbre formule cartésienne a donné lieu. Dans les paroles des chansons ou sous la forme de tags sur les murs des villes, que lui vaut une telle popularité qui lui a fait largement franchir les frontières de la philosophie ? Avec autant d’humour que d’érudition, mais toujours d’une manière très accessible, le spécialiste ès cartésianisme Denis Moreau dépoussière le sens et les enjeux du « je pense, donc je suis » (ou « cogito ergo sum »), en expliquant comment ce qui n’a « certes rien d’une innovation radicale » constitue pourtant « l’unique et indépassable fondement de toute philosophie ». Il étudie donc le cogito sous tous les angles et sous toutes les variantes, notamment « dubito, ergo sum » (« je doute, donc j’existe ») de La Recherche de la vérité ou « ego sum, ego existo » (« moi je suis, moi j’existe ») des Méditations métaphysiques. Intuition directe, inférence déductive ou performance ? « Sursaut rageur » contre les prétentions du scepticisme à pouvoir douter de tout sans fin ou auto-affirmation du sujet pensant ? Le cogito est tout cela à la fois mais il est surtout, insiste Moreau, une véritable expérience à pratiquer par soi-même jusqu’à éprouver ce moment miraculeux où l’on parvient à penser – et à ressentir ! – la certitude absolue de son propre être. À cet égard, « les Méditations cartésiennes constituent un texte interactif » qui ne se contente pas de raconter de l’extérieur le récit du parcours effectué par Descartes, mais qui doit se réaliser à la première personne : « l’ouvrage [est] construit de façon que, par l’acte même de sa lecture, le lecteur accomplisse ce parcours pour son propre compte ». La version philosophique des « livres dont vous êtes le héros » en quelque sorte, mais dont il ne faut pas sous-estimer la difficulté tant elle exige une sérieuse mise en question de tout ce à quoi nous tenons et qui nous semble vrai. On comprend mieux pourquoi tout le monde se sent interpellé par le cogito et veut se l’approprier pour en livrer sa version personnelle !

À l’écoute du moderne
Publié leVivante, intime, profonde : c’est ainsi que l’on pourrait résumer la déambulation à travers l’art moderne que propose Hadrien France-Lanord dans cet ensemble d’études. De la peinture de Cézanne à la musique de Beethoven, en passant par la poésie de Hölderlin, l’intérêt de la lecture est lui aussi triple. La découverte, d’abord. Aux côtés des classiques s’avancent des noms moins connus – entre autres, les poètes américains Lorine Niedecker et James Schuyler –auquel France-Lanord nous initie. « Il s’agit […] d’inviter le lecteur à lire à son tour et par lui-même ». La philosophie, ensuite, car, chemin faisant, au détour des toiles et des airs, l’ouvrage constitue une introduction précieuse et incarnée aux pensées de l’art de Heidegger ou de Merleau-Ponty, pour ne citer qu’eux. La réflexion, enfin. Car, si l’art doit « [donner] la mesure de l’homme », sa tâche est devenue peut-être plus essentielle que jamais à l’heure de « l’absence de transcendance, de centre et de hiérarchie » où il nous incombe de réapprendre à « tisser un être-ensemble » qui n’est plus donné d’emblée. « Par sa liberté […] qui s’affirme hors des systèmes de représentation préétablis, l’art moderne a ici beaucoup à nous dire » pour peu qu’on se mette à son écoute. Il n’est pas seulement une affaire de belles choses : sans dogmatisme, il met en jeu notre être dans le monde et interroge le sens de la communauté, toujours en construction, que nous formons avec autrui. Un pas de côté salutaire par rapport à l’urgence de l’actualité qui n’a cependant rien d’inactuel.

L’Étoile du matin
Publié leAprès avoir achevé une œuvre autobiographique courant sur quinze ans et deux cycles romanesques de dix volumes (« Mon combat » et « Le quatuor des saisons »), où il était parvenu à accrocher le lecteur à un exercice d’introspection radicale, Karl Ove Knausgaard nous revient avec texte résolument fictif. C’est en effet à une série de personnages imaginaires qu’il applique cette fois son art si particulier de décortiquer le quotidien. Pour le lecteur, l’envoûtement est à nouveau au rendez-vous. On retrouve cette précision des mots et cette lenteur de l’analyse qui nous engluent dans ce qu’il y a de plus réel et auquel le romancier norvégien donne une profondeur insoupçonnée. Le narrateur nous emmène à l’endroit où l’on n’aurait pas spontanément envie de se retrouver mais que l’on prend tant de plaisir à scruter avec lui. Il parvient ainsi à magnifier la conversation avec un voisin qu’il méprise et sur lequel fantasme sa femme en le faisant basculer dans un débat entre un athée et un croyant sur la mort et l’existence de Dieu. Ailleurs, autour d’un verre de whisky partagé entre deux protagonistes, il introduit une proposition digne de la métaphysique : « Le monde est la réalité physique dans laquelle nous vivons, tandis que la réalité est aussi tout ce que nous savons, pensons de lui, et les sentiments qu’il nous inspire. » Grâce à un SMS que Katherine, une femme pasteur, reçoit de son mari (« À quelle heure atterris-tu ? Il y a une entrecôte et une bouteille de vin rouge qui t’attendent »), il nous fait partager son angoisse de ne peut-être plus l’aimer… Knausgaard nous installe dans la position inconfortable et féconde du voyeur méditant. Procédant à une dissection vertigineuse de la prose du quotidien, il réveille ainsi notre quête d’un émerveillement au jour le jour.

Khaos. La promesse trahie de la modernité
Publié le« Ce que l’on appelle modernité n’est pas la modernité » : tel est le point de départ de l’ouvrage de Raphaël Liogier. « La modernité n’est pas ce qui a dégradé le monde, mais c’est elle qui a été dégradée, et c’est ce processus même de dégradation qui a emporté le monde avec lui. » Quelle est donc cette découverte moderne aussitôt recouverte ? Si la modernité coïncide bien avec l’effondrement des absolus immatériels – divinités, valeurs, ou hiérarchies éternelles – censés organiser le cosmos, cette abolition rend possible, selon Liogier, la mise au jour d’une transcendance tout autre, « brute », obscure, sauvage qui ne surplombe plus les choses mais les porte : le khaos. « Source originelle et originale », « possibilité de tout », mouvement secret dont tout procède et auquel tout retourne, il serait l’abîme sans fond au fondement de toute chose. Les Modernes redécouvrent ainsi l’intuition des Grecs : celle d’une fécondité insondable sous-tendant une nature tout sauf « inerte ». Insaisissable, imprévisible, indéterminable, irreprésentable, ce « vide » prolixe suscite cependant une réaction d’« angoisse ». Tout sera fait pour le combler. Se met en marche la machine nihiliste cherchant – par l’accumulation compensatrice, la frénésie ordonnatrice et le scientisme desséchant – « à tout uniformiser » pour dominer un monde dont les assises se dérobent. Une autre voie s’ouvrait pourtant : celle de la singularité. Revenant sans cesse au khaos qui afflue en nous et nous relie aux autres, nous débordons toujours les identités génériques qui nous sont assignées. « Tout est singulier et transcende ainsi […] les catégories d’appartenance » Si, à la longue, les affirmations théoriques monolithiques de l’auteur déconcerteront peut-être le lecteur, il faut saluer l’ambition conceptuelle et l’ampleur philosophique de ce livre singulier.

Les arts
Qu’est-ce que la vérité quand le fait divers prend l’épaisseur du mythe ? C’est la question que creuse avec brio Justine Triet dans son…

Cette pièce met en scène l’épuisement du corps, engagé dans la petite histoire qu’est ce spectacle et la grande qu’est l’existence. Un tourbillon…

Le parcours de l’exposition permanente de l’institution parisienne fait peau neuve pour mieux mettre en lumière les vies concrètes d’étrangers qui…

Oh ! La belle vie !
Faut-il jeter le bébé avec l’eau du bain ? A priori, non. Jeter l’eau, ça oui ! C’est même bienvenu, surtout si elle est sale, surtout si elle est souillée,…

Jeu
Questionnaire de Socrate
Dans Sauvage, roman qui paraît en cette rentrée à L’Iconoclaste et qui fait suite au succès de Liv Maria (2020), on retrouve la marque de l…


